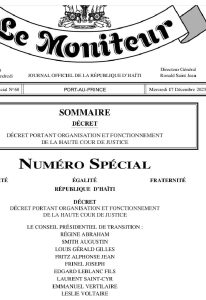Selon le ministre de l’Économie et des Finances, Alfred Fils Metellus, 243 millions de dollars, c’est le montant annoncé par la BID pour des projets en Haïti lors de la visite de son président dans le nord. Lors d’une interview accordée à Le Quotidien News ce 16 mai 2025, l’économiste Guy Mary Hyppolite a indiqué que si les mécanismes de suivi, de transparence et de responsabilisation sont renforcés, ce montant peut contribuer à des avancées concrètes, notamment dans les secteurs ciblés.
Le Quotidien News (L.Q.N) : 243 millions de dollars, c’est le montant indiqué par la Banque Interaméricaine de Développement (BID) pour des projets en Haïti par son président, Ilan Goldfajn, selon le ministre de l’Économie et des Finances, Alfred Fils Metellus, lors de la huitième édition de l’initiative « Les mardis de la Nation» qui s’est tenue le 13 mai 2025 à la Primature. Pour certains observateurs, cette somme ne va rien apporter en termes de contribution dans le processus de développement d’Haïti. À ce propos, qu’en pensez-vous ?
Guy Mary Hyppolite (G.M.H) : Cette inquiétude est légitime et reflète une certaine fatigue collective face aux promesses non tenues ou mal exécutées. Toutefois, il serait injuste de rejeter d’emblée l’impact potentiel de cet engagement. Le véritable problème ne réside pas tant dans le montant annoncé, mais plutôt dans la capacité institutionnelle du pays à gérer ces fonds de manière transparente, efficace et durable. Si les mécanismes de suivi, de transparence et de responsabilisation sont renforcés, ces 243 millions peuvent contribuer à des avancées concrètes, notamment dans les secteurs ciblés. Mais sans gouvernance solide, même les milliards restent stériles.
L.Q.N : À en croire le ministre Alfred Fils Metellus, la priorité va être accordée à la santé et à l’eau potable. Cela est-il un bon choix ? Pourquoi ?
G.M.H : Oui, c’est un bon choix. La santé publique et l’accès à l’eau potable sont des fondements essentiels au développement humain. Dans un pays où de nombreuses régions souffrent d’épidémies d’origine hydrique et d’un système de santé délabré, investir dans ces secteurs, c’est renforcer les capacités de survie, de résilience et de développement des communautés. Toutefois, on pourrait également évoquer l’éducation, la sécurité et la création d’emplois comme secteurs prioritaires. Ces domaines sont interconnectés : sans éducation ni sécurité, les avancées sanitaires restent fragiles. Le choix des priorités doit donc s’appuyer sur une analyse globale des besoins et des urgences territoriales.
L.Q.N: Selon les propos du ministre Metellus, 143 millions sont déjà disponibles pour des projets dans le Nord. Pourquoi ce dernier occupe-t-il une si grande place ?
G.M.H : Le Nord, notamment le département du Nord, est une région stratégique historiquement négligée, mais à fort potentiel. Le choix de cette zone peut s’expliquer par plusieurs facteurs : une volonté de déconcentration des investissements, l’existence de projets pilotes ou déjà amorcés dans la région et une stabilité relative par rapport à d’autres zones du pays. De plus, la réhabilitation de l’hôpital Justinien à Cap-Haïtien, l’un des centres hospitaliers les plus importants du pays, justifie à elle seule une partie de cet investissement. Cette initiative peut aussi être perçue comme une tentative de renforcer les pôles régionaux pour désengorger la capitale.
L.Q.N : Ils sont nombreux les organismes internationaux qui disent constamment qu’ils ont décaissé de l’argent pour financer des projets de développement en Haïti. Alors que, si l’on fait un coup d’œil sur le terrain, nous verrons que les impacts de ces investissements sont rarement fructueux. Il est toujours difficile de voir l’impact positif de ces décaissements sur Haïti réellement. Selon vous, pourquoi est-il difficile de voir les retombées positives de ces projets ?
G.M.H : Il existe plusieurs raisons à cela. D’abord, le manque de gouvernance et de transparence dans la gestion des fonds est un frein majeur. Ensuite, une grande partie des aides passe par des ONG internationales qui contournent les structures étatiques, ce qui empêche toute appropriation nationale des projets. De plus, les projets sont souvent conçus sans tenir compte des réalités locales, sans consultation communautaire, ni continuité à long terme. Il y a aussi une grande faiblesse dans le suivi-évaluation, rendant difficile l’appréciation des impacts. Enfin, l’instabilité politique chronique paralyse la mise en œuvre effective des initiatives.
L.Q.N : Pourquoi le président de la BID a-t-il été reçu dans le Nord et non dans le département de l’Ouest ?
G.M.H : La décision de recevoir le président de la BID dans le Nord peut être interprétée de plusieurs manières. D’une part, il s’agit peut-être d’un message symbolique fort visant à démontrer que le développement ne doit pas être concentré uniquement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. D’autre part, les conditions de sécurité dégradées à Port-au-Prince ont sans doute influencé ce choix, rendant toute visite officielle risquée. Enfin, le Nord représente une zone où des projets concrets peuvent être rapidement mis en œuvre, ce qui permet à la BID de mieux illustrer ses efforts sur le terrain.
Propos recueillis par :
Jackson Junior RINVIL
rjacksonjunior@yahoo.fr