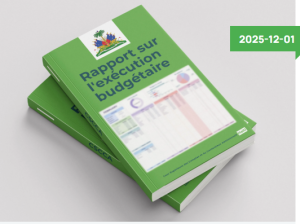Dans le contexte actuel d’Haïti, caractérisé par une crise sécuritaire aiguë, une faible capacité de production nationale et une dépendance aux importations, un budget de guerre bien ciblé pourrait être une première réponse pragmatique et rapide dans la lutte visant à éradiquer le banditisme en Haïti, estime l’économiste Guy Mary Hyppolite lors d’une interview accordée à Le Quotidien News le 5 avril 2025. Il estime, par ailleurs, que le budget de guerre permettrait de renforcer les forces de sécurité et de stabiliser certaines zones sans bouleverser complètement l’organisation économique.
Le Quotidien News (LQN) : Quelle différence existe-t-il entre un budget de guerre et une économie de guerre ?
Guy Mary Hyppolite (G. M. H) : Le budget de guerre concerne uniquement les finances publiques : c’est un document de planification budgétaire qui oriente les dépenses de l’État vers les besoins militaires et sécuritaires.
L’économie de guerre, en revanche, est un mode d’organisation globale de l’économie nationale en temps de guerre ou de crise extrême. Elle implique la mobilisation de toutes les ressources du pays (production, main-d’œuvre, consommation) au service de l’effort de guerre : réquisitions, nationalisation de certaines industries, contrôle des prix, rationnement, redirection de la production industrielle, etc.
En somme, le budget de guerre est un outil financier, tandis que l’économie de guerre est une transformation structurelle de l’économie.
L.Q.N : Dans le contexte socio-économique et politique actuel, entre un budget de guerre et une économie de guerre, laquelle/lequel sera mieux adapté(e) pour permettre au pays d’avoir les moyens pour contrecarrer l’offensive des bandes armées ?
G. M. H : Dans le contexte actuel d’Haïti, caractérisé par une crise sécuritaire aiguë, une faible capacité de production nationale et une dépendance aux importations, un budget de guerre bien ciblé pourrait être une première réponse pragmatique et rapide. Il permettrait de renforcer les forces de sécurité et de stabiliser certaines zones sans bouleverser complètement l’organisation économique.
Cependant, si le conflit s’enlise ou si la situation sécuritaire dégénère davantage, une économie de guerre pourrait s’imposer comme une nécessité pour mobiliser durablement les ressources du pays dans un effort collectif de survie et de reconstruction. À court terme, un budget de guerre semble plus adapté ; à moyen ou long terme, seule une transition vers une économie de guerre pourrait garantir une riposte nationale efficace.
L. Q. N : Quel impact l’adoption d’un éventuel budget de guerre peut-il avoir sur l’économie nationale ?
G. M. H : L’adoption d’un budget de guerre peut avoir des impacts mixtes sur l’économie nationale :
• Positifs : amélioration de la sécurité, restauration de la confiance des citoyens et des investisseurs, relance de l’activité économique dans les zones pacifiées.
• Négatifs : diminution des investissements publics dans les secteurs sociaux, augmentation de la dette publique, inflation liée aux dépenses militaires non productives, risques de corruption liés à la gestion d’un budget exceptionnel.
Si le budget de guerre n’est pas accompagné d’un mécanisme de contrôle rigoureux et de mesures pour protéger les secteurs essentiels, il peut aggraver les déséquilibres économiques et sociaux du pays.
L. Q. N : Qui contrôlera les actions dépensières du Conseil Présidentiel de Transition (CPT ) ?
G. M. H : Normalement, dans un État démocratique, les dépenses publiques doivent être contrôlées par des institutions indépendantes comme :
• La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) : censée auditer la gestion des fonds publics et valider l’exécution budgétaire ;
• Le Parlement : lorsqu’il est fonctionnel, il exerce un contrôle sur l’adoption et l’exécution du budget ;
• La société civile et la presse : jouent un rôle de veille citoyenne.
Mais dans le cas actuel du CPT (Conseil Présidentiel de Transition), plusieurs incertitudes se posent :
• Le Parlement est dysfonctionnel, donc il n’y a pas de contrôle législatif traditionnel.
• La CSCCA a vu sa crédibilité érodée par le passé.
• Le CPT lui-même est une entité non élue, dont les mécanismes de reddition de comptes ne sont pas encore clairement définis.
• Le manque de transparence, les risques de clientélisme et de détournements de fonds sont donc réels.
Pour finir, si des garde-fous institutionnels ne sont pas mis en place rapidement, le risque est grand que l’utilisation des fonds du budget de guerre échappe à tout contrôle réel, ce qui pourrait aggraver encore plus la méfiance envers l’État et affaiblir encore plus les institutions.
Propos recueillis par :
Jackson Junior Rinvil
rjacksonjunior@yahoo.fr