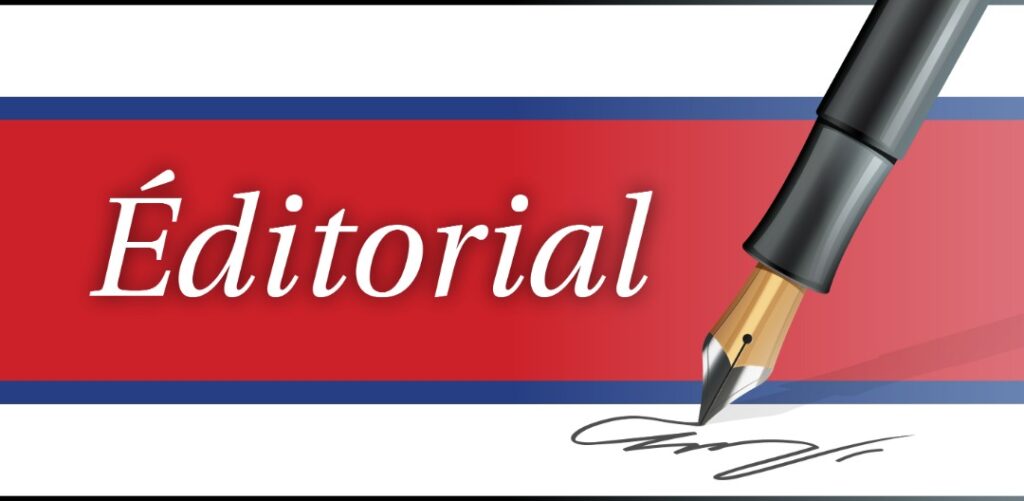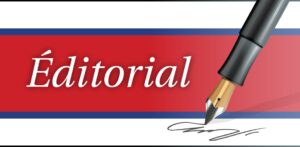La chronique crise politique qui persiste depuis des années a tout obnubilé. Elle a voilé un tas de problèmes majeurs qui nécessitent des traitements minutieux et urgents. Cette situation qui attire toutes les attentions déclasse dans l’actualité et l’opinion publique des sujets cruciaux et vitaux pour la République.
Dans de précédents éditoriaux, nous avons déjà fait le point sur certains de ces problèmes. Nous avons parlé de l’effondrement en catimini du système éducatif, de la récupération de la crise par toutes les catégories sociales en vue de l’exploitation des plus vulnérables. On avait parlé du projet d’éclipser ce qui reste encore de la production nationale. Pour ce week-end, cet éditorial met en lumière un autre aspect de la face cachée de la crise, qui est l’environnement.
La dégringolade constatée dans ce secteur ne date pas d’hier. Elle a toujours été perçue, et de fait, comme une épée de Damoclès pendue sur la tête de la nation. Mais avec la politique vicieuse, intéressée et mesquine pratiquée par la classe politique et les élites ces derniers temps, tout s’est accéléré à un rythme effréné.
Un petit regard sur la capitale haïtienne en dit long. En termes de considération écologique, c’est la catastrophe. On dirait une ville en ruine. Déjà, en temps normal, la ville de Port-au-Prince, du point de vue écologique, représentait une menace pour la vie de la population à cause des constructions anarchiques, de l’obstruction des canaux d’évacuation, entre autres. Quelques millimètres de pluies suffisent à inonder la ville. Les montagnes d’immondices par ci et par là. Les bouts, tout au long des rues, exposaient tous les passants. À présent, n’en parlons pas, Port-au-Prince s’écroule sous les yeux complices des autorités.
C’est le cas également pour beaucoup d’autres villes, dont Léogâne mise à genoux par la rivière Rouyonne. Les constructions anarchiques qui progressent de plus en plus aussi. L’abattage des bois et l’occupation des terres cultivables s’ajoutent à la liste. Sur les réseaux sociaux, la ville du Cap-Haïtien a défrayé la chronique. Des images de l’état d’insalubrité de la ville tournaient en boucle. Cette situation, malheureusement, est la même pour beaucoup d’autres villes en proie à des inondations fréquentes et à un problème d’érosion criant.
Cette descente aux enfers, dans un contexte où le monde se mobilise pour la protection de l’environnement, devrait être une préoccupation nationale. Une priorité parmi d’autres pour l’État haïtien trop déchiqueté par une crise sans issue. Les instances concernées sont aux abonnés absents. Quelle est la mission du ministère de l’Environnement dans ce contexte-ci ? Qu’est-ce qu’il est en train de faire ? Comment compte-t-il pallier la situation plus que désastreuse ? S’est-il fait remplacer par le SMGRS qui, à son tour, a disparu du radar ?
Quoi qu’on dise, quoi qu’on pense. Aussi irrationnel qu’on puisse être, quelque chose doit être fait à ce niveau. Trois mois après l’ouverture de la saison cyclonique, le pays est toujours épargné des catastrophes naturelles majeures. Mais doit-on continuer à prendre la roue-libre ? Faut-il continuer à diriger le pays sur le bon vouloir du Bon Dieu ? L’État doit cesser d’être une accumulation d’identités disparates, mais un système cohérent et utile. La situation est pénible et les problèmes écologiques ont des pas d’avance sur l’État condamné à rectifier le tir. Qui sortira gagnant dans cette bataille, vraisemblablement, perdue d’avance par les dirigeants ?
Daniel Sévère