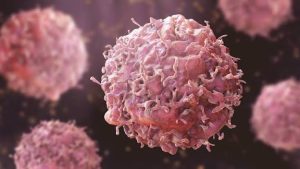Entre 2010 et 2023, la population de la ville a augmenté de près de 35%, passant d’environ 190 000 à plus de 257 000 habitants.Aujourd’hui la ville du Cap compte plus de 400,000 habitants soit une augmentation de 36% en seulement deux (2) ans ,selon l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) et du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH).
Cap-Haïtien, surnommée la « ville aux mille visages », est confrontée depuis plusieurs années à une urbanisation rapide et souvent non planifiée. Cette évolution démographique résulte principalement d’un afflux important de populations rurales cherchant de meilleures opportunités économiques et un accès facilité aux services essentiels.
Cette augmentation rapide de la population exerce une forte pression sur les infrastructures urbaines. Les quartiers historiques, autrefois bien organisés, se voient peu à peu envahis par des constructions improvisées, fréquemment réalisées sans permis ni respect des normes urbanistiques. Ces nouveaux quartiers informels manquent généralement d’accès à l’eau potable, à l’électricité, à un système d’assainissement adéquat et à des services de santé. L’urbanisation non maîtrisée a aussi un impact négatif sur l’environnement. La disparition progressive des espaces verts, la pollution due à une gestion inadéquate des déchets et la déforestation autour de la ville aggravent la vulnérabilité face aux risques naturels tels que les inondations et les glissements de terrain.
Impact social et économique
La concentration urbaine génère des tensions sociales, notamment en raison du manque d’emplois formels et de logements adaptés. Beaucoup d’habitants vivent dans des conditions précaires, avec un accès limité aux services publics de base. « Le marché du travail informel explose, mais les opportunités stables restent rares », explique Mme Roseline Jean, urbaniste en charge du Plan Local de Développement Urbain. Par ailleurs, cette urbanisation rapide entraine une montée des inégalités. Les plus démunis s’entassent dans des quartiers vulnérables, tandis que les zones plus favorisées bénéficient de meilleures infrastructures. Cette disparité sociale pose des défis importants pour la cohésion sociale et le développement harmonieux de la ville. D’autres acteurs locaux, comme des associations communautaires, s’organisent pour sensibiliser la population à l’importance de la gestion durable de la ville et promouvoir des solutions adaptées aux réalités locales.
Témoignages du terrain
M. Jean-Baptiste Pierre, résident du quartier Laborue, décrit les difficultés quotidiennes : « Nous vivons dans un espace qui ne cesse de se remplir, mais les services ne suivent pas. L’eau potable est rationnée, les rues sont souvent impraticables, pas de l’électricité. Pourtant, beaucoup de familles continuent de venir ici, espérant un meilleur avenir ».
Interventions internationales BID et Banque mondiale en action
En mars 2020, la Banque mondiale a approuvé une subvention de 56 millions USD pour le Cap-Haïtien Urban developpement Project. Ce projet vise à rendre la ville plus vivable et résiliente en améliorant les infrastructures urbaines, la mobilité, la sécurité routière, et la résiliente face aux catastrophes naturelles. Il inclut aussi la requalification du front de mer, des routes, des infrastructures de quartier et le renforcement des capacités gouvernementales à entretenir des investissements. Les chiffres montrent l’ampleur des défis ; 74% des résidents dans des quartiers à forte densité, 72% des constructions sont situées en zones inondables, et seul un très faible pourcentage de l’espace urbain est dédié aux routes et aux espaces publiques.
Rôle de la BID (Banque inter-Américaine de Développement)
La BID est un bailleur majeur dans le domaine de l’eau portable et de l’assainissement en Haïti, actif dans les villes secondaires depuis 1998, et également dans les zones rurales depuis 2006. Bien que Cap-Haïtien ne fasse pas partie des villes citées explicitement pour des projets spécifiques de la BID, l’appui global au secteur montre un engagement durable en faveur de l’amélioration des services essentiels, ce qui pourrait bénéficier indirectement aux efforts de la ville.
Vers une urbanisation maîtrisée : enjeux et solutions
Face à ces défis, plusieurs initiatives sont en cours pour tenter de canaliser la croissance urbaine. Le Plan Local de Développement Urbain vise à encadrer les constructions, à améliorer l’accès aux services publics et à renforcer la résilience de la ville face aux risques naturels. Toutefois, ces efforts sont souvent freinés par le manque de ressources financières, le déficit de personnel qualifié et des contraintes administratives.
La participation citoyenne apparaît comme un levier indispensable. « Sans l’implication active des habitants, il est impossible d’adopter des solutions pérennes », souligne Mme Roseline Jean. Des projets pilotes, incluant la réhabilitation des quartiers dégradés, la création d’espaces verts et l’amélioration de la collecte des déchets, montrent déjà des résultats encourageants.
Perspectives
Cap-Haïtien est à un moment charnière de son développement. Pour que la ville puisse gérer efficacement sa croissance, il est crucial de renforcer la coordination entre autorités locales, acteurs privés et société civile. L’adoption de politiques publiques inclusives, durables et innovantes est nécessaire pour transformer les défis de l’urbanisation en opportunités de développement.
Une meilleure planification urbaine, combinée à des investissements ciblés dans les infrastructures et à une sensibilisation accrue de la population, pourra permettre à Cap-Haïtien de devenir un modèle de développement urbain en Haïti.
Recommandations pour une urbanisation durable à Cap-Haïtien
Pour relever les défis posés par l’urbanisation rapide, plusieurs mesures concrètes peuvent être envisagées :
1. Renforcer la planification urbaine
Il est essentiel d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’aménagement urbain clair et rigoureux, qui intègre les besoins actuels et futurs de la population. Ce plan doit prévoir des zones dédiées au logement, aux activités économiques, aux espaces verts et aux infrastructures publiques.
2. Améliorer les infrastructures de base
Investir dans le développement et la modernisation des réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de gestion des déchets est primordial pour garantir un cadre de vie sain aux habitants.
3. Encourager la construction réglementée
Mettre en place des contrôles efficaces pour limiter les constructions anarchiques et promouvoir des normes de construction sécuritaires, respectueuses de l’environnement et adaptées au climat local.
4. Promouvoir la participation citoyenne
Impliquer les habitants dans les processus de décision, notamment à travers des consultations publiques, des comités de quartiers et des campagnes de sensibilisation, afin d’assurer que les politiques urbaines répondent aux besoins réels des communautés.
5. Développer des programmes d’éducation et de sensibilisation
Informer la population sur les risques liés à une urbanisation non planifiée, sur les bonnes pratiques environnementales et sur l’importance de la préservation des espaces naturels.
6. Mobiliser des ressources financières
Rechercher des partenariats avec des organismes internationaux, des ONG et le secteur privé pour financer les projets d’aménagement urbain et les programmes sociaux liés.
7. Renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles
Intégrer dans les plans urbains des mesures de prévention et de gestion des risques liés aux inondations, aux glissements de terrain et autres catastrophes, surtout par la création de systèmes d’alerte et d’infrastructures adaptées.
Olry Dubois, Agroéconomiste