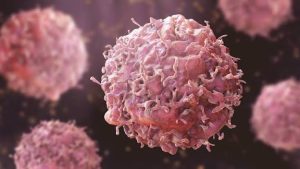Haïti et le changement. Deux mots qui, depuis des décennies, s’accompagnent dans les discours officiels, les promesses électorales et les rêves d’un peuple lassé. Pourtant, dans la réalité, ces deux notions semblent suivre des trajectoires parfaitement parallèles — proches dans les mots, mais qui n’ont pas encore la capacité de se croiser dans les faits.
« Ici, tout change pour que rien ne change », ironise Marie-Lourde, 42 ans, institutrice à Carrefour. « Depuis que j’enseigne, j’ai vu défiler les présidents, les réformes, les projets. Mais dans ma salle de classe, les enfants ont toujours faim, et les parents ont toujours peur du lendemain ».
Sa phrase sonne comme un verdict. En Haïti, le changement est une promesse qui se répète, une illusion qui rassure, mais jamais une réalité tangible.
Une république à bout de souffle
Depuis la fin de la dictature des Duvalier, Haïti a expérimenté presque toutes les formes de pouvoir : militaire, populiste, technocratique, provisoire, internationalisé. À chaque transition, le même discours : refondation nationale, développement durable, renaissance politique. Mais la vie des citoyens, elle, demeure la même.
Selon la Banque mondiale (2024), près de 60 % des Haïtiens vivent sous le seuil de pauvreté, et l’espérance de vie moyenne plafonne à 64 ans. Port-au-Prince, la capitale, croule sous les ordures et de nombreuses zones sont contrôlées par les gangs. À la campagne, les récoltes s’appauvrissent faute de soutien étatique.
« Nous ne vivons plus, nous survivons », confie un professeur de philosophie du Cap-Haïtien. « L’État haïtien est devenu une fiction administrative ».
La corruption, matrice de l’immobilisme
Haïti figure encore parmi les 10 pays les plus corrompus au monde, selon Transparency International (2024).
Mais réduire le problème à un simple vol d’argent serait trop facile. La corruption, ici, est systémique. Elle est inscrite dans les réflexes, les relations, les habitudes.
Un ancien fonctionnaire du ministère des Travaux publics, sous anonymat, raconte :
« On ne travaille pas pour servir, mais pour se servir. Chaque poste est vu comme une opportunité de rente, pas de responsabilité ».
Ce constat brutal illustre la nature du mal. Là où le changement demande discipline, transparence et sacrifice, Haïti répond par clientélisme, favoritisme et impunité.
Et pourtant, tout le monde crie au changement — du politicien jusqu’au citoyen — mais personne ne veut vraiment payer le prix qu’il exige.
Une jeunesse à la dérive
Si le changement devait venir de quelque part, ce serait sans doute de la jeunesse. Mais celle-ci, découragée, se tourne vers l’exil.
Selon le PNUD, près de 80 % des jeunes diplômés souhaitent quitter le pays dans les cinq années suivant leur formation.
« Je ne veux pas partir parce que je n’aime pas mon pays, mais parce que mon pays ne m’aime pas », dit Judler, 24 ans, étudiant en administration à Port-au-Prince. « Ici, tout est bloqué : les emplois, les opportunités, l’avenir ».
Dans une société où les diplômes n’ouvrent plus aucune porte, la fuite des cerveaux devient une hémorragie silencieuse. Ceux qui restent vivent dans une tension constante, entre frustration et résignation.
« Nous formons des esprits pour un pays qui ne les attend pas », admet une professeure d’université. « Comment parler de changement quand l’intelligence fuit ? »
L’insécurité : le chaos comme norme
Haïti d’aujourd’hui, c’est aussi la peur devenue routine.
Le Centre d’Analyse et de Recherche en Droits Humains (CARDH) rapporte plus de 3 000 enlèvements depuis le début de 2025. Les gangs contrôlent près de 80 % de la capitale.
Dans les quartiers populaires, les habitants vivent au rythme des rafales. « Quand on sort le matin, on n’est jamais sûr de rentrer le soir », dit un chauffeur de tap-tap de Delmas.
Ce climat de violence généralisée annihile toute tentative de reconstruction.
« Le changement ne peut pas naître dans la peur », explique le journaliste Eddy Charles. « Et en Haïti, la peur est devenue le premier ministre de facto ».
Un État fantôme
Le paradoxe haïtien, c’est un pays qui a des ministères sans politique, des institutions sans autorité, des fonctionnaires sans mission.
Les hôpitaux sont en ruine, les écoles publiques croulent, les routes se décomposent.
À Hinche, une agricultrice témoigne : « Nous n’avons ni eau, ni électricité, ni route. Mais chaque fois qu’il y a une élection, on vient nous promettre le changement. Après, plus rien ».
Dans de nombreuses régions, ce sont les ONG et les églises qui remplacent l’État. Ce bricolage social maintient la survie, mais empêche toute vision d’avenir.
« Un pays qui délègue son destin à des organisations étrangères a déjà renoncé à lui-même », souligne le politologue Jean Robert Philogène.
Une question de mentalité
Peut-on vraiment parler de changement sans parler des Haïtiens eux-mêmes ? C’est la question qui dérange, mais qu’il faut oser poser.
« Nous avons fait de la résignation une culture nationale », observe l’économiste Kesner Milfort. « Chacun attend que l’autre agisse. Le citoyen accuse l’État, l’État accuse le peuple, et au final, personne ne bouge. »
La fatalité est devenue un abri. On préfère croire que « se Bondye ki vle sa » plutôt que de reconnaître nos responsabilités collectives.
Pourtant, un peuple qui accepte sa misère ne peut espérer sa liberté.
Comparaisons dérangeantes
Regardons ailleurs. Le Rwanda, après le génocide, a reconstruit un pays presque neuf. Le Salvador, rongé par les gangs, a retrouvé une relative stabilité.
Pourquoi eux, et pas Haïti ?
« Parce qu’en Haïti, chaque tentative de réforme dérange un réseau d’intérêts », explique Philogène. « Le désordre est rentable et la stabilité fait peur à ceux qui profitent du chaos ». Autrement dit, tant que la survie du système dépendra du désordre, le changement restera une ligne parallèle, visible à l’horizon mais jamais atteignable.
Le peuple fatigué
« Nou bouke », disent-ils tous.
Dans les marchés, les écoles, les églises, cette phrase résonne comme une prière éteinte. La population ne croit plus aux promesses.
Elle ne se révolte plus. Elle endure.
Un vieil homme rencontré à Léogâne résume la situation d’une voix rauque : « Tout politisyen di l ap chanje peyi a, men se menm mizè a ki chanje fòm. »
Cette lassitude collective est peut-être le plus grand obstacle au changement : quand la souffrance devient normale, l’injustice devient invisible.
Vers une réconciliation avec soi-même
Et pourtant, malgré tout, Haïti continue de battre. Des jeunes créent des startups à partir de rien. Des enseignants tiennent tête à la misère. Des artistes dénoncent, des prêtres s’engagent, des citoyens s’entraident.
« Haïti ne changera pas d’un coup d’État ou d’un coup de baguette magique », affirme le pasteur Daniel Jean-Louis. « Mais elle changera, peut-être, le jour où chacun décidera de vivre autrement, même sans attendre les autres ».
Probablement que le véritable changement ne viendra pas du haut, mais du bas. Pas des institutions, mais des consciences. Pas du pouvoir, mais du courage.
Briser le parallélisme
Haïti et le développement durable sont-ils deux droites parallèles ? Dans la géométrie de l’histoire, on dit qu’il existe un espace, où même les parallèles peuvent se rencontrer : celui de la volonté humaine.
Ces deux lignes ne commenceront-elles à se rapprocher le jour où les Haïtiens comprendront que le changement ne se décrète pas, mais se construit — jour après jour ? Ce jour-là, Haïti ne cessera-t-elle pas d’être une promesse inachevée pour redevenir un pays possible ?
Olry Dubois