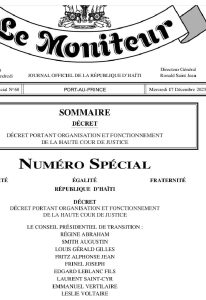L’ambassade d’Haïti en République dominicaine a rendu publique une note circulaire officielle annonçant la suspension de la délivrance des visas B1/B2 par les États-Unis à tous les ressortissants haïtiens, indépendamment de leur statut ou du type de passeport qu’ils détiennent. Une décision sans précédent, justifiée par Washington au nom de la sécurité nationale, qui relance les débats sur l’équilibre diplomatique entre Haïti et les États-Unis.
Selon la Note émise par la représentation haïtienne à Saint-Domingue, la mission diplomatique américaine a invoqué la nouvelle loi sur l’Immigration et la Nationalité des États-Unis, récemment amendée par une proclamation présidentielle. Celle-ci entend, entre autres, « restreindre l’entrée sur son territoire des ressortissants de certains pays, y compris les Haïtiens, afin de protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale ».
Cette formulation place Haïti dans une catégorie sensible, sans distinction entre les détenteurs de passeports ordinaires, officiels ou diplomatiques. En d’autres termes, aucun ressortissant haïtien ne peut actuellement solliciter un visa touristique ou d’affaires de type B1/B2, sauf dans des cas d’exception qui, selon les usages diplomatiques, peuvent inclure des motifs humanitaires ou médicaux. Toutefois, à ce jour, les autorités américaines n’ont publié aucun détail sur d’éventuelles dérogations applicables aux citoyens haïtiens.
Des précédents préoccupants
La décision s’inscrit dans une tendance plus large de durcissement migratoire aux États-Unis, notamment sous l’administration actuelle, qui continue de faire de la sécurité aux frontières une priorité. En plaçant Haïti sur cette liste restreinte, Washington renforce une dynamique d’exclusion déjà perceptible dans d’autres dossiers, comme le traitement des demandeurs d’asile haïtiens ou les expulsions collectives.
Pour plusieurs experts en relations internationales, ce genre de mesures unilatérales, surtout lorsqu’elles visent indistinctement des ressortissants d’un même pays, s’accompagnent souvent d’une montée des tensions diplomatiques. En ce sens, certains observateurs anticipent déjà des appels à une réponse diplomatique haïtienne structurée, que ce soit par l’ouverture d’un dialogue bilatéral ou par la saisine d’organismes régionaux comme l’Organisation des Etats Américains (OEA) ou la CARICOM.
Silence officiel, mais réactions attendues
Jusqu’ici, aucune réaction publique n’a été formulée par le gouvernement haïtien ni par le Ministère des Affaires Étrangères. Cependant, des acteurs du secteur migratoire ainsi que des organisations de défense des droits humains commencent à s’interroger, en privé, sur la portée réelle de cette décision et ses conséquences pour les Haïtiens engagés dans des démarches diplomatiques ou professionnelles à l’international.
Par ailleurs, plusieurs analystes estiment que des associations haïtiennes de la diaspora pourraient bientôt se mobiliser. Dans des précédents similaires, ces organisations ont dénoncé des politiques perçues comme discriminatoires ou contraires à l’esprit du multilatéralisme. Le caractère global et non différencié de la suspension pourrait renforcer cette dynamique de contestation.
Une mesure qui renforce le sentiment d’isolement
Pour de nombreux Haïtiens (fonctionnaires, artistes, hommes d’affaires ou simples citoyens), cette suspension vient aggraver un sentiment d’isolement croissant. Elle limite considérablement les opportunités de mobilité internationale, y compris pour des démarches médicales, éducatives ou économiques. Et dans un contexte de crise prolongée en Haïti, où les structures institutionnelles sont fragilisées, la coupure de ce canal diplomatique constitue un coup dur supplémentaire.
En parallèle, cette mesure complique aussi la tâche des représentations diplomatiques haïtiennes, en particulier en République dominicaine, qui font face à une demande croissante d’explication et de médiation.
Vers une réponse haïtienne coordonnée ?
Si la note circulaire diffusée par l’ambassade d’Haïti se limite à un constat formel, elle pourrait constituer le prélude à une prise de position plus affirmée du gouvernement haïtien. Pour plusieurs diplomates de carrière, il est impératif de clarifier les conditions de cette suspension, d’en évaluer la portée juridique et de chercher à rétablir un canal de négociation ouvert avec les autorités américaines.
Dans ce contexte tendu, la responsabilité revient désormais aux autorités haïtiennes d’engager une réponse cohérente, équilibrée et concertée, afin de défendre la souveraineté du pays tout en évitant une détérioration supplémentaire des relations bilatérales.
Hector Marcoslev