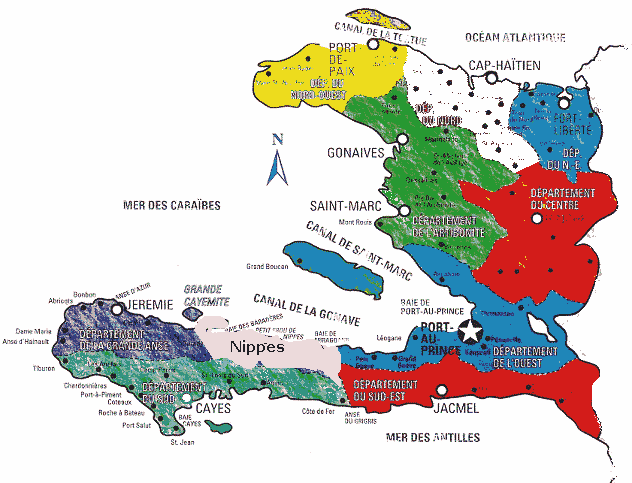Dans un pays en quête de repères et de stabilité, la présidence est devenue le rêve ultime de presque tous. Des jeunes diplômés aux vendeurs de rue, chacun se voit déjà à la tête de la nation. Mais derrière cette frénésie politique se cache une profonde crise de valeurs, où l’ambition personnelle a remplacé le sens du devoir collectif.
«Dans ce pays, on ne rêve plus de servir, mais de régner ».
— Propos recueillis auprès d’un jeune observateur politique de Port-au-Prince.
Depuis quelques années, Haïti semble être entrée dans une ère de confusion politique où l’ambition a pris le pas sur la vocation. Dans les rues, les cafés, les radios ou les réseaux sociaux, un constat s’impose : tout le monde veut devenir président. Le phénomène touche toutes les couches sociales : des diplômés aux chômeurs, des jeunes militants aux pasteurs, des commerçants aux artistes.
Mais d’où vient cette obsession collective pour le pouvoir suprême ? Est-ce un symptôme du désespoir national ou une manifestation de l’ego collectif ?
Le pouvoir comme mirage
Dans un pays où l’État peine à assurer les besoins essentiels de la population, la présidence est perçue non comme une responsabilité, mais comme l’unique voie vers la reconnaissance, la richesse et la sécurité. Être président, pour beaucoup, signifie échapper à la misère et au mépris.
« Ici, on croit que devenir président, c’est se sauver soi-même avant de sauver les autres », explique le sociologue fictif Jean-Robert Paul, de l’Université d’État d’Haïti.
« C’est une forme de revanche sociale, une manière de dire : mwen rive, mwen pap janm soufri ankò ».
Cette perception du pouvoir comme instrument de revanche transforme la politique en spectacle et fait du leadership une compétition de popularité plutôt qu’une mission de service public.
L’absence de repères
L’un des drames de la société haïtienne, c’est que les institutions n’offrent plus de modèle crédible. Les anciens dirigeants, pour la plupart discrédités par la corruption, ont laissé derrière eux une image ternie du pouvoir. Résultat : la présidence devient un rêve accessible à tous, puisque ceux qui y sont arrivés n’ont pas toujours fait preuve de mérite exceptionnel.
Un chauffeur de taxi à Delmas confie :
« Si yo fè li prezidan, poukisa pa mwen ? Mwen konn pale, mwen konn wè sa ki pa mache nan peyi a ».
Cette phrase, banale en apparence, illustre un malaise profond : la confusion entre opinion et compétence, entre indignation et préparation.
Les réseaux sociaux : incubateurs d’illusions
Les plateformes numériques ont amplifié le phénomène. Aujourd’hui, un micro et une caméra suffisent pour s’autoproclamer leader politique. Sur TikTok, Facebook, Instagram ou X, les “présidents virtuels” se multiplient. Chacun y va de son discours patriotique, souvent sans plan ni vision claire, mais avec la conviction que son tour viendra.
« Nou tout kapab prezidan si Bondye vle », écrit un influenceur suivi par plus de 50 000 personnes.
Cette démocratisation du discours politique, si elle traduit une liberté d’expression, cache aussi un danger : la banalisation de la fonction présidentielle. Quand tout le monde se dit apte à gouverner, plus personne ne se prépare sérieusement à le faire.
Une crise de légitimité
L’envie de pouvoir s’accompagne rarement d’une envie de responsabilité. La politique, au lieu d’être un engagement, devient une échappatoire. Dans un pays sans perspectives économiques, le pouvoir est devenu le dernier rêve possible. Et dans ce rêve collectif, la compétence n’a plus sa place.
« La présidence n’est plus un projet de société, c’est devenu un projet personnel », déplore Josué Louissaint, mémorant en histoire.« Ce n’est pas le pays qu’on veut transformer, c’est sa propre vie. »
Cette réalité explique pourquoi la scène politique haïtienne est encombrée de figures éphémères, de candidats improvisés et de promesses sans lendemain.
Entre désillusion et urgence
Le peuple, lui, regarde ce spectacle avec un mélange de fatigue et d’amertume. Chaque nouveau prétendant promet le changement, mais le scénario reste le même. L’espoir s’érode, la confiance s’évapore, et le pays continue de tourner en rond.
« Mwen bouke tande pale de chanjman », lance un marchand du centre-ville. « Tout moun ap di yap sove peyi a, men pèsonn pa sove anyen ».
Cette phrase, brute et sincère, résume la fracture entre le discours politique et la réalité du quotidien. Le peuple n’attend plus un messie, mais un système qui fonctionne.
Vers une culture de responsabilité
Il est temps de rappeler que diriger un pays, ce n’est pas un rêve, c’est un devoir moral et intellectuel. Gouverner exige de la préparation, de l’humilité et une conscience aiguë des conséquences de ses décisions.
Haïti n’a pas besoin de plus de présidents, mais de plus de citoyens responsables, capables de servir avant de régner.
« Le vrai pouvoir, c’est celui qu’on exerce sur soi-même avant de le demander aux autres », affirme un jeune professeur de philosophie à Cap-Haïtien.
Si chaque Haïtien cherchait d’abord à être président de sa propre vie — à gouverner ses choix, ses émotions, sa discipline — le pays aurait déjà commencé sa transformation silencieuse.
Conclusion
Haïti vit une crise d’identité politique où l’ambition remplace la mission. Tant que la présidence sera vue comme une récompense et non comme un service, le pays restera prisonnier d’un cercle vicieux.
La vraie révolution ne viendra pas d’un nouveau président, mais d’un nouveau rapport au pouvoir. Le jour où les Haïtiens comprendront que le leadership, c’est d’abord le courage de bien faire ce qu’on a à faire, ce jour-là, le rêve de changement cessera d’être un slogan et deviendra enfin une réalité.
Dubois Olry