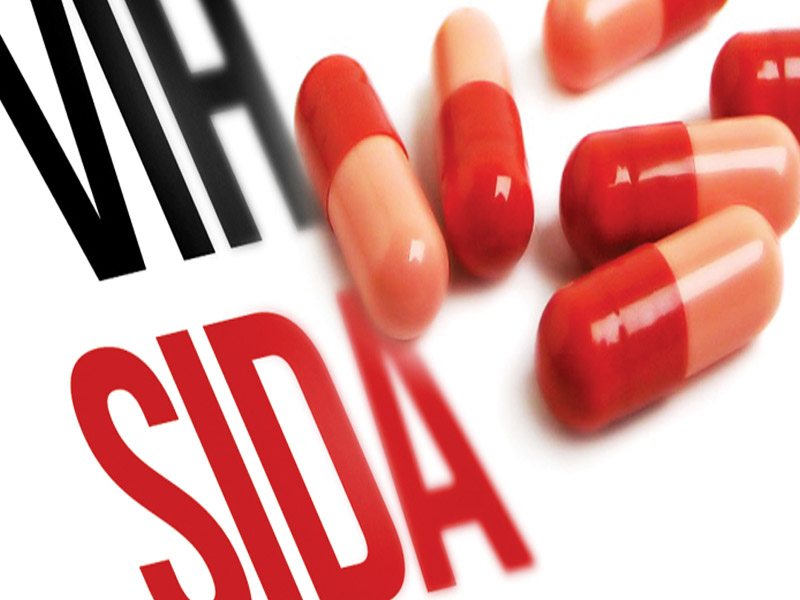Plus de vingt ans de progrès dans la lutte contre le VIH/SIDA en Haïti sont aujourd’hui menacés. La coupe drastique de l’aide de l’USAID et du PEPFAR, combinée à la persistance de comportements à risque et à la pauvreté, pourrait replonger le pays dans une crise sanitaire d’une ampleur dramatique.
Selon l’ONUSIDA, près de 150 000 Haïtiens vivent avec le VIH. Dans un pays marqué par l’instabilité et la pauvreté, la maladie ne se limite pas à une question de santé. Elle détruit des familles, fragilise le tissu social et alourdit un système médical déjà exsangue.
« Le VIH n’est pas seulement une maladie médicale. En Haïti, il est au croisement de la pauvreté, de l’insécurité et du manque d’accès aux soins », explique le Dr Bernadin Vasthie.
Le choc des coupes de l’USAID
Depuis 2003, le plan d’urgence présidentiel américain (PEPFAR) a permis de sauver des millions de vies, en fournissant des antirétroviraux gratuits et en soutenant des centaines de cliniques. Mais depuis 2024, Washington a réduit de près de 90 % ses financements.
Conséquence : les stocks de médicaments diminuent dangereusement. Certaines structures annoncent qu’elles ne pourront pas tenir au-delà de quelques mois. « C’est difficile d’expliquer à un patient qu’il ne trouvera plus ses médicaments. Pour lui, c’est comme une condamnation à mort », déplore le Dr John Wesley Sterling, qui exerce à l’hôpital Bethesda dans le nord du pays.
Même inquiétude du côté de la société civile
« Nous n’avons des antirétroviraux que jusqu’en juillet. Après cela, je ne pourrai pas regarder ces enfants mourir sans rien faire », avertit Marie Denis-Luque, fondatrice de l’organisation CHOAIDS.
Prévention : un talon d’Achille
Au-delà du manque de médicaments, la prévention reste insuffisante. L’usage du préservatif demeure faible, souvent freiné par des tabous religieux ou culturels. L’éducation sexuelle n’est pas intégrée au système scolaire, et la stigmatisation décourage encore beaucoup de malades à révéler leur statut. « Comment espérer contrôler l’épidémie si parler de sexualité reste un sujet tabou ? », s’interroge la Dr Sabine Lustin, directrice de l’ONG Promoteurs de l’Objectif Zéro SIDA.
Au-delà des recommandations officielles, certains jeunes expriment leurs doutes. Lors d’une séance de sensibilisation, Kermlensie Adolphe, une étudiante en médecine, a confié :
« Avec préservatif, surtout lorsqu’on ne connaît pas la personne et qu’on n’est pas sûr qu’elle ait fait un test de dépistage pour savoir si elle est séronégative. De nos jours, avec l’infidélité qui prend le dessus, tu peux penser que ton partenaire est fidèle, mais à un moment ou à un autre, il peut avoir un rapport avec une personne atteinte du sida. Et après, c’est toi qui risques de l’attraper. Du coup, le plus important reste d’avoir un conjoint qui te respecte, qui soit honnête et fidèle. C’est le moyen le plus sûr, car en dépit de tout, peut-on vraiment affirmer que le préservatif protège à 100 % ? Je ne pense pas ».
Une crise multidimensionnelle
La situation sanitaire est aggravée par plusieurs facteurs :
La pauvreté : de nombreux malades n’ont pas les moyens de s’alimenter correctement, ce qui réduit l’efficacité des traitements.
L’insécurité : les gangs qui contrôlent certaines routes bloquent l’accès aux soins.
La stigmatisation : de nombreux séropositifs préfèrent interrompre leur traitement plutôt que d’être identifiés.
La résistance aux traitements : toute rupture d’antirétroviraux favorise l’apparition de souches résistantes du virus.
« L’arrêt brutal des ARV est dangereux. Le virus devient résistant, et nous risquons de revenir vingt ans en arrière », alerte encore le Dr Bernadin Vasthie.
L’appel des experts
Face à cette menace, les professionnels de santé tirent la sonnette d’alarme.
« Couper les financements serait catastrophique. Cela met en péril deux décennies de progrès. Nous avons trop avancé pour reculer maintenant », insiste le Dr Wesler Lambert, directeur intérimaire de Zanmi Lasante.
De son côté, Christine Stegling, directrice adjointe de l’ONUSIDA, estime que la coupe des financements pourrait provoquer « une augmentation de 400 % des décès liés au SIDA » dans les prochaines années.
Quelles pistes pour éviter le pire ?
Rétablir et diversifier les financements internationaux.
Renforcer les programmes de prévention et d’éducation sexuelle.
Garantir la distribution gratuite et massive des préservatifs et du PREP.
Lutter contre la stigmatisation par des campagnes médiatiques et communautaires.
Améliorer la logistique et la sécurité pour assurer l’accès aux soins malgré la violence des gangs.
Une urgence nationale et internationale
La lutte contre le VIH/SIDA en Haïti est à un tournant décisif. Après des années d’avancée, le pays risque une régression dramatique. Si rien n’est fait, des milliers de vies pourraient être perdues, et des décennies de progrès balayés.
Le VIH n’est pas une fatalité. Mais sans solidarité internationale et sans changement d’attitude à l’échelle nationale, l’épidémie pourrait redevenir une véritable hécatombe.
Olry Dubois, Agroéconomiste olrydubois@gmail.com