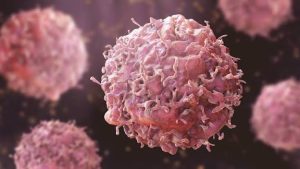Dans un pays plongé dans la crise et l’incertitude, les jeunes Haïtiens se réfugient de plus en plus dans les réseaux sociaux. Lieu de fuite, de consolation ou d’expression, l’univers numérique devient leur nouvel espace émotionnel. Mais derrière les sourires filtrés et les vidéos joyeuses, se cache souvent une solitude profonde et silencieuse.
Port-au-Prince. Là où l’avenir semble suspendu, où les jours se ressemblent et les nuits se redoutent, beaucoup de jeunes Haïtiens trouvent refuge dans l’écran lumineux de leur téléphone. TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook : autant de fenêtres sur un monde parallèle, plus léger, plus supportable.
« Quand tout va mal autour de toi, il reste ton téléphone », confie Taïna, 22 ans, étudiante en communication. « Je parle à des gens que je ne verrai jamais, mais au moins, je me sens moins seule ».
Pour cette génération, le numérique n’est pas qu’un passe-temps : c’est une thérapie silencieuse, une façon de respirer dans un environnement saturé d’angoisse.
Quand l’électricité s’éteint, que la peur des tirs résonne ou que les rêves s’effritent, le téléphone reste l’unique lumière.
La quête de reconnaissance virtuelle
Les “likes” et les commentaires sont devenus les nouveaux battements du cœur social.
Une photo appréciée, un statut partagé, et le moral remonte. Mais à l’inverse, le silence numérique pèse lourd.
« Si je poste une photo et que personne ne réagit, j’ai l’impression de ne plus exister », avoue Melissa, 20 ans, vendeuse en ligne.
Pour le Dr Jean Gardy Louis, psychologue clinicien, cette dépendance affective traduit une fragilité collective :
« Les jeunes Haïtiens vivent dans une société où la valorisation est rare. Les réseaux comblent ce vide, mais de manière temporaire ».
La recherche d’attention devient alors une quête existentielle. Plus qu’un loisir, c’est une nourriture émotionnelle.
Une illusion de bonheur collectif
Sur les réseaux, tout semble beau. Les filtres effacent la fatigue, les vidéos font rire, les “stories” colorent une réalité souvent grise.
Mais derrière chaque publication se cache parfois un désespoir silencieux.
« On montre ce qu’on voudrait être, pas ce qu’on est », explique Frantz, 24 ans, photographe amateur. « Moi, je poste des couchers de soleil parce que la réalité autour de moi est trop moche ».
Selon la sociologue Myrtha Charles, cette mise en scène permanente crée un profond déséquilibre :
« Les jeunes projettent une image de force, alors qu’ils sont fréquemment en détresse émotionnelle. Les réseaux renforcent la dissonance entre le “moi réel” et le “moi numérique” ».
Un refuge qui isole
Paradoxalement, plus ils sont connectés, plus ils s’isolent.
Les conversations physiques diminuent, les regards se perdent. Dans les lycées, les professeurs remarquent que les pauses ne sont plus des moments d’échange, mais de silence collectif.
« Chacun reste sur son téléphone. Ils rient, mais pas ensemble. Ils ne vivent plus les moments, ils les postent », déplore Marlène D., professeure au Cap-Haïtien.
Une étude récente de l’Observatoire de la jeunesse haïtienne (OJA) révèle que 63 % des jeunes se sentent « plus seuls qu’avant » malgré leur présence constante sur les réseaux.
Les effets se répercutent sur le sommeil, la concentration et les relations familiales.
Le refuge devient une cage dorée.
Exister à travers la douleur
Les algorithmes accentuent le paradoxe : les publications les plus émotionnelles — tristes, révoltées ou vulnérables — génèrent plus d’engagement.
Sans le vouloir, les jeunes finissent par monnayer leur douleur pour exister.
« Quand j’écris que je ne vais pas bien, les gens réagissent. C’est comme si je devais souffrir pour qu’on me voie », confie Nadège, 18 ans, élève de philo à Hinche.
Ces « réactions » apportent une reconnaissance rapide, mais entretiennent une dépendance émotionnelle qui fragilise encore plus les esprits.
Déconnexion forcée : une panique silencieuse
Quand le courant s’éteint, que le signal tombe, beaucoup paniquent.
« Quand il n’y a pas de réseau, j’ai l’impression d’être prisonnier de ma tête », raconte David, 21 ans.
Le téléphone n’est plus un outil : c’est une bouée. Et sans lui, le vide remonte à la surface.
Les relations humaines s’en ressentent :
« Je me sens plus comprise par mes amis sur WhatsApp que par ma propre famille », admet Ruth, 23 ans, étudiante à Jacmel.
Les émotions sont désormais filtrées, mesurées, postées. Le contact humain, lui, s’efface.
Réapprendre à vivre hors ligne
Face à ce phénomène, quelques institutions éducatives et organisations de jeunes tentent de réagir.
À Delmas, l’association Konekte Ayiti organise chaque mois une « journée sans écran » où les jeunes discutent, jouent, débattent, rient — sans téléphone.
« C’est difficile au début », témoigne Patrick, animateur. « Mais après quelques heures, ils redécouvrent le plaisir d’exister en vrai ».
Selon la psychologue Béatrice Dérilus, l’enjeu n’est pas de diaboliser les réseaux sociaux, mais d’en reconstruire l’usage émotionnel :
« On doit apprendre aux jeunes à reconnaître leurs émotions avant de les publier. À chercher la chaleur humaine avant les notifications ».
Vers une conscience numérique
Les réseaux sociaux ne sont pas le problème en soi. Ils ont permis à beaucoup de jeunes de s’exprimer, de militer, de lancer des projets.
Mais ils nécessitent une éducation émotionnelle et critique : comprendre que tout ce qui brille à l’écran n’est pas bonheur.
Les experts recommandent :
• de limiter le temps d’écran,
• de pratiquer des activités réelles (sport, lecture, discussion),
• et de cultiver la conscience numérique : savoir pourquoi on poste, et pour qui.
« Les jeunes doivent comprendre qu’ils ne sont pas leurs stories. Ils sont bien plus que leurs publications », conclut la sociologue Myrtha Charles.
Un miroir, pas un refuge
Les réseaux sociaux sont devenus le miroir d’une génération qui doute, qui espère et qui cherche à se reconstruire dans le chaos.
Mais un miroir ne console pas : il reflète seulement.
« On ne fuit pas la réalité en se connectant », écrivait une jeune internaute haïtienne dans une publication virale.
« On la retrouve, mais en plus brillante, plus cruelle et souvent plus seule ».
Olry Dubois