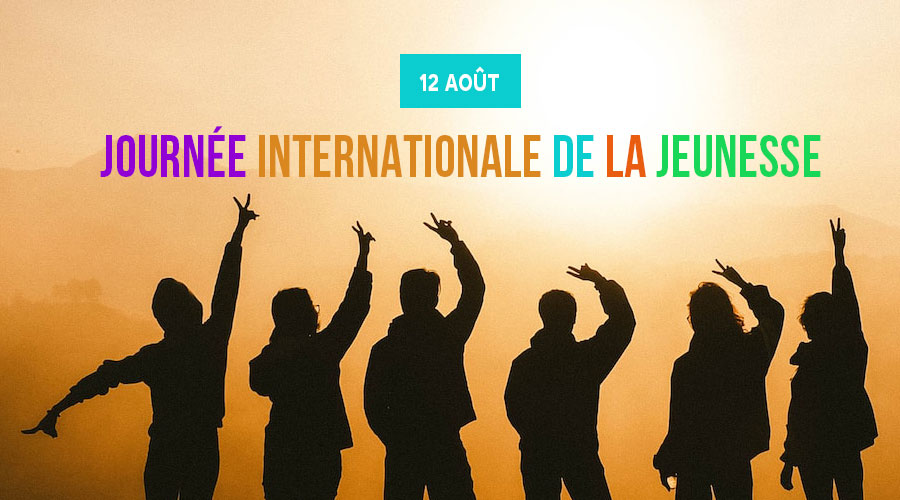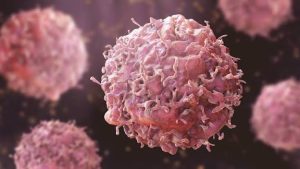Haïti traverse une crise multidimensionnelle : économique, sécuritaire, humanitaire, dont les ravages jettent une ombre menaçante sur les rêves et les espoirs de sa jeunesse. Avec la montée de l’insécurité, les jeunes sont confrontés à des difficultés majeures qui mettent en péril leur avenir. Le 12 août dernier, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse placée par l’ONU sous le thème « L’action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà », il est légitime de s’interroger : quelle place la société haïtienne réserve-t-elle réellement à sa jeunesse ?
Port-au-Prince est aujourd’hui le théâtre d’une guerre de gangs sans précédent. En 2023, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) estimait que les groupes armés contrôlaient jusqu’à 80 % de la capitale. Selon l’ONU, plus d’un million de personnes étaient déplacées à l’intérieur du pays en juin 2025. Cette spirale de peur frappe de plein fouet les jeunes, privés d’un environnement stable pour se construire.
Cette violence entrave aussi l’économie. En décembre 2023, l’économiste Kesner Pharel, invité sur Magik 9, dressait un constat glaçant : « L’insécurité, cette variable qu’on peut avoir tendance à négliger, est en passe de devenir un problème structurel. Sans sécurité, sans défense, on ne peut avoir de croissance économique. » Pour la jeunesse, cette réalité se traduit par un horizon bouché : chômage massif, précarité et absence de perspectives.
L’éducation, pilier du développement, n’est pas épargnée. Les écoles ferment faute de sécurité ou sont réquisitionnées pour accueillir des déplacés. Les infrastructures sont détruites, les enseignants terrorisés. Selon un rapport du Bureau des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) publié en mai 2025, plus de 1 600 écoles avaient fermé fin avril, privant 243 000 enfants et adolescents d’accès à l’apprentissage.
Pourtant, cette jeunesse est loin d’être insignifiante sur le plan démographique. Selon les données onusiennes, plus de 54 % de la population haïtienne a moins de 24 ans. « Avec un tel poids démographique, investir de façon judicieuse dans les jeunes pourrait aider à produire des résultats probants pour l’avenir du pays », peut-on lire dans un article de l’UNICEF publié dans le cadre du Forum des adolescents et des jeunes sur l’employabilité.
Par ailleurs, l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne (OJH) dénonçait en avril 2024 l’absence de jeunes dans les organes de gestion de la transition politique, qualifiant cette exclusion de « manquement grave » dans un pays où l’avenir se joue sur leur engagement.
Cette mise à l’écart ne se limite pas aux grandes négociations politiques. Elle se manifeste aussi dans l’absence d’une véritable politique publique de jeunesse, structurée et financée. Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) rappelle que les jeunes Haïtiens expriment massivement leur désir de contribuer au développement durable, mais se heurtent à un mur : manque d’opportunités, déficit de formation et climat général d’instabilité.
Toutefois, la jeunesse haïtienne manifeste une forme de résilience assez souvent face à cette situation. En mai 2025, un protocole d’engagement a été signé entre quinze organisations de jeunesse et cinq partis politiques, avec le soutien du PNUD, pour « renforcer la démocratie par une participation accrue des jeunes », sans compter des organisations et associations de jeunes qui malgré la déchéance aiguë cherche à éveiller l’âme de la jeunesse haïtienne.
Si les conditions d’existence étaient favorables, accès à l’éducation, sécurité, opportunités économiques, la jeunesse pourrait devenir un puissant vecteur de changement. Elle dispose de l’énergie, de la créativité et du nombre pour infléchir la trajectoire du pays.
Marie-Alla Clerville